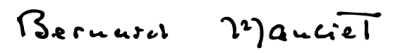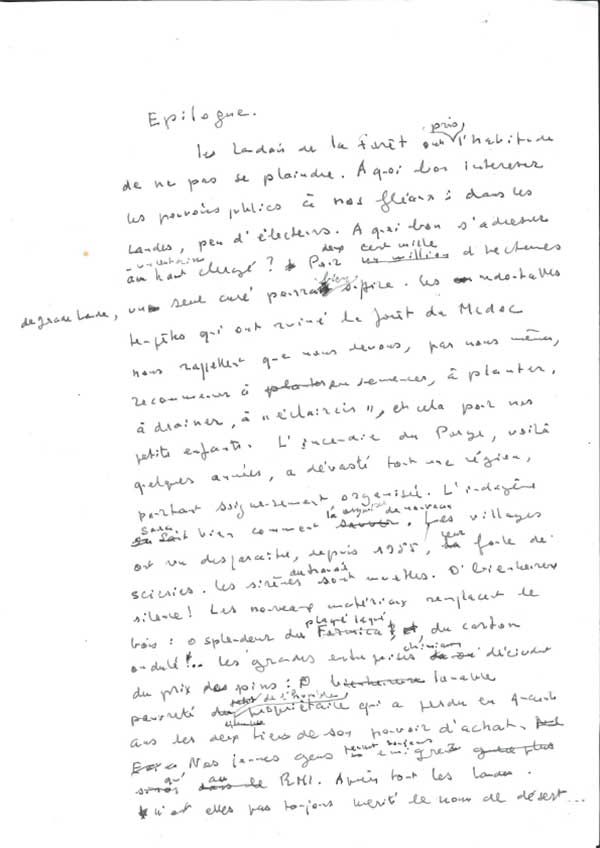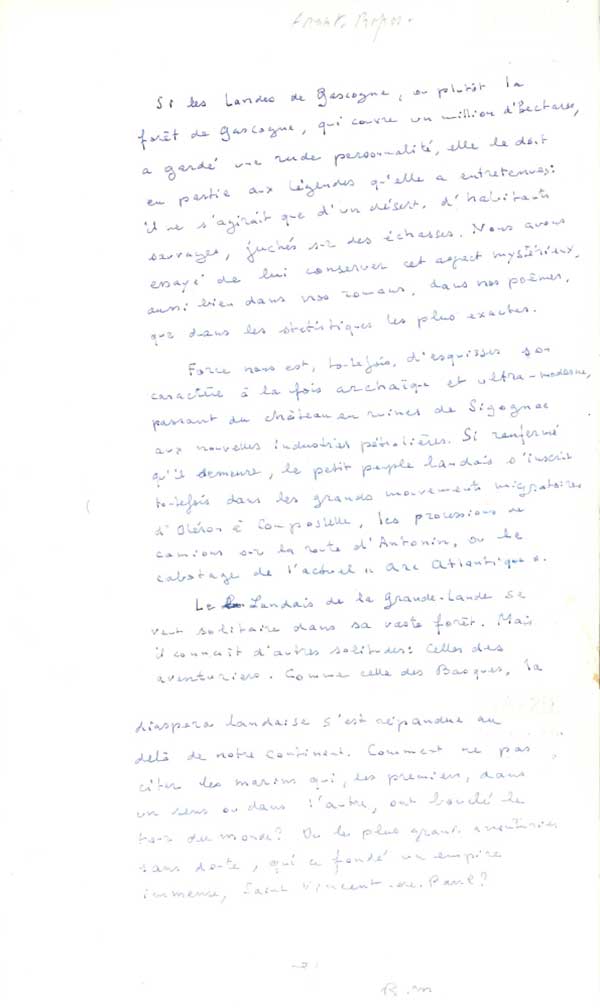-
2 essais
LE GOLFE DE GASCOGNE
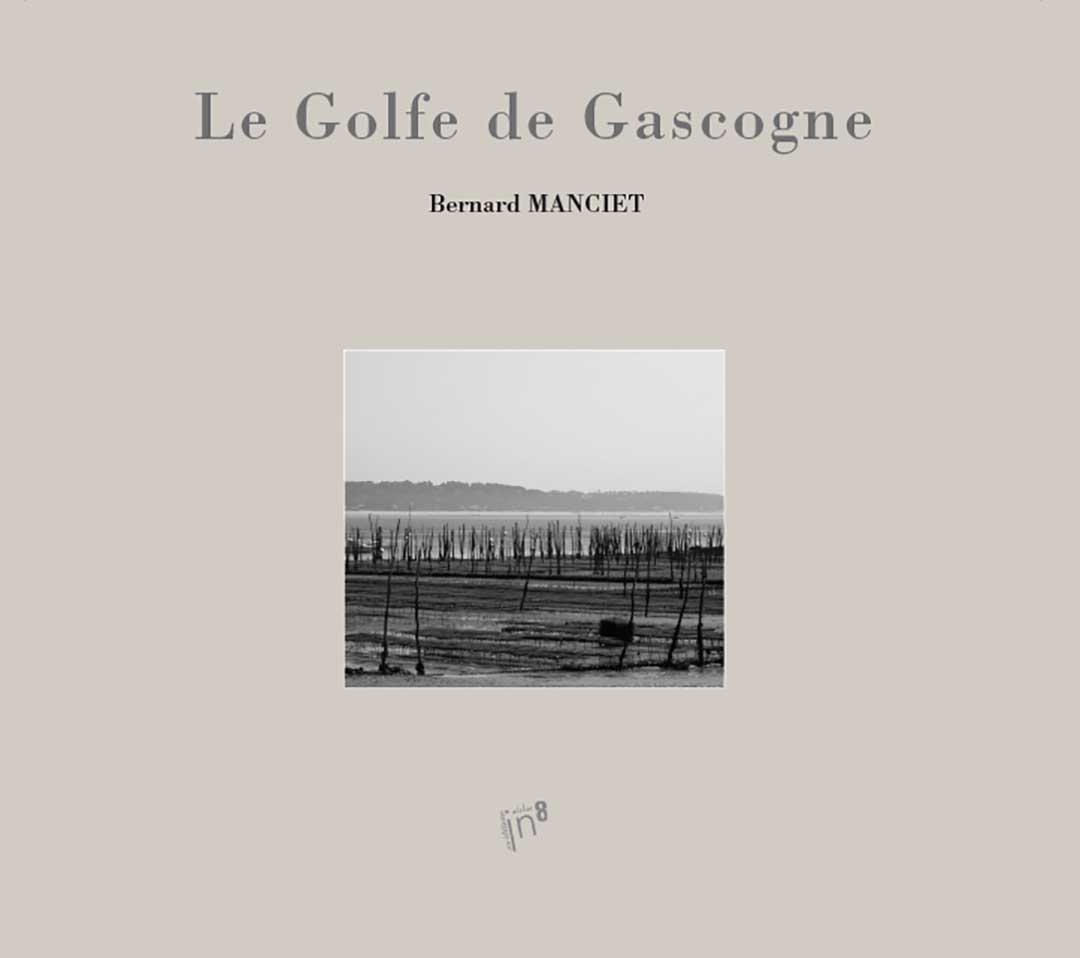
EXTRAIT
VERS THULÉ
Parvenu aux bords de l’Océan, l’ingénieux Ulysse, nous dit-on, y chercha le rivage des morts, s’aventurant vers le Septentrion et le pays sans lumière des Cimmériens. Il fut pris et repris par de puissants courants marins et par de rudes vents, emporté des falaises aux plages de sable fin. Lisbonne fondée, ses armes et ses boucliers laissés en quelque ville de ce Far West, il oublia. Tous ceux qui, par la suite, allèrent récitant de port en port les hexamètres de ses hasards et de ses infortunes, sirènes de basses-cours et filles du soleil à l’appui, perdirent à leur tour la mémoire de ces parages mal fréquentés par des dieux impossibles, de ces marées qui redescendent les embouchures en rechignant, et du vaste Golfe.
Et ce qu’on appelait l’Autre Golfe des Galates devint comme une absence dans la conscience des peuples d’Occident. Rien, siècle après siècle, n’aura cogné plus en vain que ces inimaginables vagues qui retombent, avec des claquements d’élastique, des gravités concaves, de grands chuintements de lessive, sur ces espèces de déserts sans histoire, sept à huit cents kilomètres de pierre abrupte, de San Sebastián à La Corogne, trois cents de sable et de caillou d’Hendaye à Rochefort, un millier de kilomètres de tempêtes dont s’est détournée la mémoire. À l’articulation de ce compas presque à angle droit, les Barbares d’Isturits invoquaient dans le feu le cheval de Mémoire, depuis dix mille ans, au-dessus de l’Océan souterrain qui s’entend dans les grottes. Ils l’ont oublié lui-même sans remords.
Il arrive bien aux vols de palombes ou d’alouettes, lorsqu’elles suivent la côte gasconne en octobre, surprises par des vents contradictoires ou la neige précoce des Pyrénées, de se disperser à tort et à travers sur les Landes, pour avoir perdu tout à coup leurs chemins immémoriaux. Eux aussi, peut-être, ne sachant plus les routes du vieil Océan, les exégètes de nos jours avec ceux d’autrefois, désorientés, en viennent à tourner et retourner leur quête des Enfers vers Pouzolles, la Laconie, la Crète, ou cette Achérusie du Pont-Euxin ; à rechercher l’Océan qui nourrit, qui accroît les étoiles du soir, qui ouvre leur porte aux nuages dorés des Hespérides, dans la direction de la mer d’Azov ; l’Ouest, source, comme ils le disent, de la nuit, vers le nord ; et ses dieux où ils ne sont pas.
Roulé par le Claude-Bernard , un paquebot plutôt instable, mais brusquement sujet à une surnaturelle lenteur et comme immobilisé, lorsque, entre l’escale de Vigo et celle de la Gironde, il pénètre dans la brume opaque, il faut avoir connu l’absence, autour de soi, de toute image, de tout reflet même, ce qu’on nomme l’Hadès, pour éprouver sur ces eaux planantes, avec la régularité des trompes de brume, qu’il n’y a plus de temps. Les passagers dorment. L’équipage, les stewards sont devenus des ombres, « jusques à tant qu’au soir nous abordons vers les confins, là où le soleil ne passe plus sur la tête des hommes, tellement qu’une perpétuelle nuit les obscurcit, demeurant misérables en perpétuelles ténèbres ». On est entré, pour sûr, dans l’hébétude du Léthé.
Et si nous devions jamais parvenir à une côte – mais l’heure de la marée et le désir secret de ne plus aborder en retardaient l’échéance – quels survivants pourrions-nous y trouver ? « Toute l’Antiquité durant, la terre qui s’appelle aujourd’hui Pays Basque, avec ses ports, ses anses, ses bois épais […] ne se distinguait pas autrement par ses habitants qui vécurent dans une presque absolue obscurité. » Quant aux Gascons sauvages des dunes floues, toujours effondrées, toujours reculant, un peuple qui n’en est pas un. Tous peuples hypothétiques.
Où les Ligures, où les Ibères ? Simples désignations pratiques. Peuples inventés, qui sait, et littéraires. Car lorsqu’un semblant de hameau galicien se risque à apparaître, au soleil levant, à flanc de falaise, il ne semble, vu de la mer, que réminiscence : « Au moment où le soleil monta au-dessus des flaques splendides, un bourg se découvrit… » « En bas, on sacrifiait un taureau noir. »
Remonter encore, de la plage landaise, le courant de Huchet, ce n’est que scander un vieux poète : « De leurs rames, ils franchissent les longs replis, sous les arbres de toutes sortes qui les ombragent, et ils coupent sur les eaux placides le reflet des forêts vertes. » Torturés par les grammairiens, qui les confondirent dans un même peuple imaginaire, Basques et Gascons devinrent-ils autre chose que philologie ? Tout au plus peuples d’un Âge d’or bien révolu, peuples en somme rêvés : les Phéniciens [à ces] peuples rudes, et ignorants… de malice, les méchancetés de l’Asie et de la Grèce ». De là viendront encore les persécutions, « auprès de la fin du monde », puisque dans ces parages se trouve sans nul doute la race épouvantable de Thubal. Et tout compte fait, il ne s’agit guère que de franges de peuples qui, à l’étroit sur une bande de terre stérile, ne se cherchent qu’au large de la mer, où l’on puisse les perdre de vue.
Et puis sera l’Amérique. Éblouissante de métaux, elle fera oublier les montagnes espagnoles, que l’on apercevait pourtant du rivage, étincelantes d’or ou de quelque chose de semblable, et la terre surtout de Santander : « En cette terre-là […] quelques montagnes vinrent à ardre, et pleines qu’elles étaient de métaux, l’or et l’argent s’étant fondus, les hommes commencèrent à s’émerveiller. » Puis naîtront les empires du charbon et du fer, faisant passer chez les Anglo-Saxons la puissance romaine. Qui dès lors se souviendrait de l’Ibérie, de son or, de son minerai, dont l’empire de Rome ne pouvait point se dispenser, s’exténuant avec eux ? Qui se souviendrait des glorieuses montagnes toutes de fer de la Biscaye et des Cantabres ?
Pas de divinités, enfin, pas de peuple. Or entre La Corogne et Soulac, le Golfe de Gascogne entaille dans le territoire des grands dieux une sorte de néant. Les Lusitaniens, aux armes bruyantes, acclament à grands « Hu! » le caractériel Arès, dont le demi-frère, toutefois, l’infatigable piéton, Héraclès, n’osa pas franchir l’Eume ni se fier au pays des chevaux. Des Gaules de Cérunnos, le cerf mystique aux encombrants bois est venu misérablement échouer dans la banlieue bordelaise. Cybèle se plaisait dans le Gers, dont elle ne fût descendue pour rien au monde. Et puisqu’il serait vain de chercher quelque nom de divinité parmi les peuplades de la côte, gageons qu’elles vivaient dans l’athéisme, à moins qu’elles ne dissimulassent leurs dieux, les enfouissant dans les dunes, ou qu’elles ne se soient toujours interdit de prononcer leur nom. Peut-être encore les avaient-elles portés, sur la mer, où leurs géantes et leurs dracs allaient fraterniser avec ceux de l’Irlande ; plus loin encore, sur les bords du Danube, où nos tribus suspendaient leurs ex-voto en l’honneur de la divine Cantabrie. On dirait que leur patrie se situe dans un ailleurs toujours plus lointain.
De sorte que, perdu dans la brume, le navire ne sait plus « ni le point de noroît, ni celui de l’aurore, ni où tombe sous la terre le soleil des vivants », car il n’est plus de peuples repérables, de gisements miniers répertoriables, ni de dieux connus, s’il en est même quelqu’un. D’autant plus angoissée dès lors, la halte du caboteur si, devenu « à peine réel » au milieu de tant de brouillard insonorisé, il entend brusquement s’amplifier un cri « suraigu, terrifiant qui emplit le vide et s’en va déchirer les lointains […], parti de ces notes très hautes qui n’appartiennent d’ordinaire qu’aux femmes, mais avec quelque chose de rauque qui indique plutôt le mâle sauvage ; il a le mordant de la voix des chacals et il garde quand même on ne sait quoi d’humain qui fait davantage frémir… Il avait commencé comme un haut bramement d’agonie, et voici qu’il s’achève et s’éteint en une sorte de rire, sinistrement burlesque, comme le rire des fous… » C’est l’irrintzina des Basques, l’anilhèth des Landais, le « grand cri » de triomphe des vieilles tribus au « gosier de singe ». Sur ces côtes, pourtant, où tout est présages, les lambeaux de la brume, au soleil, qui s’en vont en charpie, nous révèlent heureusement, quelquefois, comme la présence aussi des Dioscures favorables, si, reprenant en plus étudié l’antique jeu de nos coureurs de plages, deux surfeurs, côte à côte, glissant ensemble, l’un en quelque sorte équilibrant, les deux bras de côté, la flexion de l’autre sur une même vague qui roule les épaules.
NOTES SUR LE GOLFE DE GASCOGNE
Le Golfe de Gascogne est le prolongement maritime de Le Triangle des Landes. Bernard Manciet en fait le point cardinal d'un triptyque qui compte, outre les deux ouvrages précités auparavant publiés par les Editions Arthaud, La Maison de la Lande, dont le manuscrit resta fort longtemps dans le mystérieux coffre de Manciet à Trensacq et que les Editions de l’Atelier In8 ont publié en 2003.
C'est en tout premier lieu un "livre-monde" dans la mesure où Manciet considérait qu'il y avait eu une civilisation "vasconne" ayant marqué un territoire on ne peut plus vaste, allant de Santander jusqu'aux Sables d'Olonne.
C'est dans cet immense espace que s'inscrit ce véritable récit "épique" d'un Golfe, lieu qui fut au centre de tous les mouvements, échanges économiques, cultuels, culturels que l'Europe (en fait, le monde d'alors) a connus entre le XIème et le XXème siècle.
Pour cette réédition, nous publions deux chapitres qui avaient été refusés par les éditions Arthaud, lors de la première édition aujourd'hui épuisée : l'un traitant de Guernica et l'autre du Chemin de St Jacques de Compostelle.
PRÉFACE DE GUY LATRY
Le Golfe de Gascogne
Après le succès du Triangle des Landes (Arthaud, 1981), Bernard Manciet conçoit un projet plus ambitieux, englobant cette fois tous les territoires riverains du Golfe de Gascogne, mais du même type: une histoire menée à la fois d'un point de vue externe, objectif, et d'un point de vue « autochtone », en empathie avec les populations dont il traite, le tout porté par la plume d'un écrivain. Bref, une histoire à la Michelet, mais avec un positionnement diamétralement opposé à celui, centraliste et finaliste, de l'historien de la France (pour ne pas dire: de « France », tant il la traite comme une personne). Comme Michelet, Manciet ne se refuse aucune source, de l'archive au poème, et anime de son souffle une documentation d'autant plus gigantesque qu'elle est multiforme, de l'épopée antique aux rapports économiques contemporains. Or, de cette érudition ébouriffante, rien ne paraît dans l'ouvrage publié en 19872. A la suite d'une décision de dernière minute de l'éditeur réduisant l'ouvrage d'une centaine de pages, l'auteur, très irrité, choisit de retirer deux passages essentiels de son ouvrage: l'extraordinaire chapitre sur Saint-Jacques-de-Compostelle, coeur battant du livre, et le morceau de bravoure qu'est l'évocation minute par minute du bombardement de Guernica. Pire, il supprime toutes les notes de bas de page, ne laissant subsister de l'appareil critique qu'un mince « abrégé de bibliographie ». Quelques critiques peu soucieux de s'informer auront évidemment beau jeu de mettre au débit de l'auteur cette apparente désinvolture, et de dénoncer des affirmations sans preuves…
Depuis 1987, il a été plusieurs fois question d'établir une seconde édition, complète, de l'ouvrage. Ce n'est qu'après la mort de Bernard Manciet, en juin 2005, que le manuscrit (en fait, un tapuscrit annoté et corrigé) a pu être extrait de la masse de documents et brouillons divers laissés par l'auteur. Et là, mauvaise surprise. Si les chapitres qui manquaient à la première édition étaient bien présents, la plupart des notes, laissées inachevées, se présentaient sous une forme fragmentaire, elliptique, parfois approximative sinon erronée. Un long travail de reconstitution commençait alors, entraînant au bout du compte une relecture systématique du texte imprimé de 1987, qui s'avéra souvent fautif.
Cette exhumation des sources bibliographiques permettait de donner enfin toute sa dimension de recherche à ce qui pouvait passer pour le « roman » du Golfe de Gascogne. Comment prendre au sérieux en effet un livre s'ouvrant sur l'évocation du « croiseur bleu-sombre » d'Ulysse au large de la Corogne? Or l'auteur ne fait là que reprendre l'hypothèse développée au 1er siècle ap. J. C. par Strabon, après d'autres (Asclépiade de Myrléa, Posidonius). Dans la monumentale Géographie du géographe grec, Manciet extrait du chatoyant panorama des peuplades ibères du livre III ce qui peut alimenter sa thèse implicite de l'existence - dans la multiplicité même des peuplades, des cultures, des croyances qui se croisent, s'affrontent, se mêlent sur ce territoire - d'une civilisation du Golfe de Gascogne qui en serait, au long de deux millénaires, le socle commun. A la recherche livresque s'ajoutent de minutieuses enquêtes sur place, dont témoigne maint tableau des lieux, port après port, de Vigo à Oleron. Pourtant, nulle rêverie d'une Atlantide engloutie. Nulle évocation, ici, d'un nébuleux « esprit des lieux » dans le traitement de cette histoire, mais une attention extrême à la vie matérielle, sinon une affirmation du primat de l'économie. A la surprise, sans doute, du lecteur, beaucoup de chiffres dans cette oeuvre de poète. Beaucoup de références littéraires aussi, avec un goût particulier pour les mémorialistes, Saint-Simon par-dessus tout, fin connaisseur s'il en fut des affaires d'Espagne. Mais, dans la transcription des citations, une tendance, parfois, à traduire à sa manière, ou bien à alléger, voire à rectifier, et, pour tout dire, améliorer le texte, qui peut aller jusqu'à transmuer en poème versifié la prose de la Pasionaria (p. 30).
Outre les deux chapitres précités, le retour au tapuscrit original a permis de rétablir quelques passages supprimés dans l'édition de 1987: des bruits de bar sur les quais de Bordeaux (p. 148) ; des apparitions sur la lande (p. 166) ; le salut au « peuple de l'aube » des chasseurs et pêcheurs (p. 306).
Ecrit au milieu des années 80, ce texte porte évidemment la marque de cette date de composition, en particulier le dernier chapitre, consacré au « ressac » économique de cette époque. Depuis, les choses ont évolué, parfois vers le pire : le gisement de Lacq n'est plus qu'un souvenir, comme les hydravions de Biscarrosse; parfois dans un sens plus favorable: assurément, le Bordeaux d'aujourd'hui, gratté de neuf, ville ouverte sur son fleuve et festonnée de tramways, refusera de se reconnaître dans la « Sinistrée » qui « parle de s'enfoncer avec un métro ". Datée, aussi, la bibliographie, dont nous n'avons qu'occasionnellement actualisé les références. Aux notes de l'auteur, nous avons ajouté, lorsque la nécessité s'en faisait sentir, des « notes de l'éditeur », notamment pour la traduction des termes occitans. Enfin, si quelques corrections ponctuelles de date ou de lieu ont été effectuées, il était exclu de « corriger » quant au fond un texte qui, dans sa problématique, ses intuitions, ses paradoxes comme ses éventuelles outrances, relève de la seule responsabilité de son auteur et constitue, au plein sens du terme, une oeuvre3.
Guy Latry
LE TRIANGLE DES LANDES
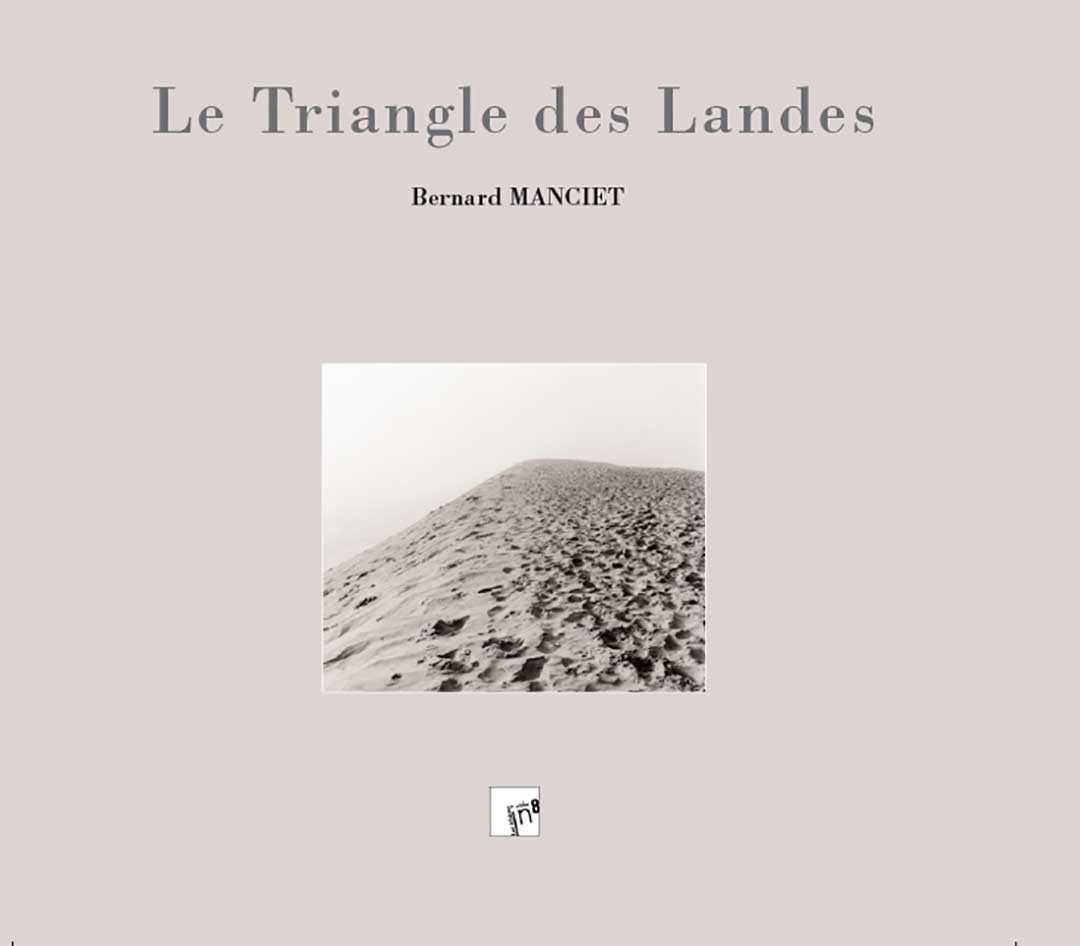
EXTRAIT
Les Landes, c’est Napoléon III. Je me demande si elles ont vraiment existé avant qu’un jour d’été de 1857 il fit halte, entre deux trains, à Labouheyre. Car enfin, est-ce exister de ne servir que de terrain vague aux civilisations de la Garonne et de l’Adour ? De ne disposer d’aucune capitale et d’aucune ville digne de ce nom, d’aucun marché, d’aucune route correctement pavée ? Les habitants même méritaient-ils le nom d’homme ? Qu’étaient-ils d’autre qu’une sorte de « peuplade tartare égarée sur les bords de l’Atlantique1 » ? Des êtres humains, que ces créatures qui faisaient l’objet, dans les académies darwinistes, des communications les plus préoccupantes sur leur caractère de quadrumanes ? Aussi bien étaient-ils en voie de disparition. S’il faut en croire le statisticien, la densité de la population classait leurs Landes parmi les déserts. Leur dégénérescence les « condamnait à ne pas vieillir » et, même, on pouvait estimer pour assuré qu’ils « tenaient peu à la vie2 ».
Certes, celui qui se prétendait l’oncle de Napoléon III avait bien eu quelque idée sur les Landes aussi. Passant par cette solitude pour se rendre à Bayonne, et prenant un peu de repos sous un châtaignier, à Louchats dit-on, il s’était vu entouré de palmiers et de baobabs, et ses iconographes en font foi. C’était un esprit vaste. « Je ferais de ce pays, dit-il, un jardin pour ma vieille garde. » Sa pensée avait le don de l’éclair. Le mot « désert » s’associa chez lui à celui de « dromadaire »3 . C’est ce qui valut aux Landes de Gascogne, par la suite, de donner l’hospitalité à des dromadaires venus d’au-delà de la Corse, et qui crevèrent tous, par excès d’humidité.
Il fallait se résoudre à la logique. On nous servit donc des buffles. Ils crevèrent par excès de sécheresse. On ne sait si les plants d’arachide, sous le Consulat, y avaient péri de l’un ou de l’autre. Le style retour d’Egypte ne nous convenait pas.
Le style Second Empire, plus éclectique, nous réussit. Il y avait de l’Algérie dans l’air. Le conseil général de la Gironde avait bien vu que les Landes pouvaient être une succursale de l’Algérie, « pays en quelque sorte à créer », comme l’Algérie, et comme elle « conquête précieuse4 ». Et Napoléon III ne disait-il pas précisément, en 1863 : « Ce qui importe, ce n’est pas de peupler l’Algérie d’individus misérables et avides, mais de favoriser les grandes associations de capitaux […] en vue d’en treprises d’assainissement, d’irrigation, d’exploitation scientifique. » Les Landes furent donc calquées sur l’Algérie. C’est l’Empereur lui-même qui imposa notre Transsaharien, la voie ferrée directe de Bordeaux à Dax. Il y avait aussi dans l’air un peu de Suez, et le désir de l’Empereur, c’est qu’il fût établi dans les Landes une canalisation. De plus, la mode en vient aux jardins d’hiver et aux essais d’arboriculture.
Les hortensias se répandirent le long de la côte landaise. Il y eut des camélias contre les maisons, au nord, et des glycines qui devaient nous donner des recueils de poèmes. Les entrelacs d’arbres en ciment, à la Biarritz, envahirent jusqu’à l’ancien château d’Albret. Le Landais Darracq n’en finit pas de s’étendre sur le Pascalum Digitaria , l’Eleusine indica , le Stentaphrum americanum . Un Walewski cultive du riz dans nos marais, « véritable révolution agricole ». Et voici qu’en 1857 – l’année de la guerre en Kabylie – le 19 juin, qui est le 14 juillet des Landes, l’empereur promulgue la loi sur « l’assainissement et la plantation en pins des Landes de Gascogne ». Ce désert deviendra un Jardin des Plantes de 900 000 hectares. La révolution est faite.
Certes, pour parler comme le Landais Garat, on guillotina peu. Mais on bouscula l’âme des Landais. Tapageurs, ils firent du tapage. Ils voulaient bien un chemin de fer, contre l’avis des experts qui conseillaient de contourner le plateau landais.
Mais ils n’en voulaient pas, craignant pour leurs troupeaux la fureur des locomotives.
Ils étaient partisans des forêts de pins, qui devaient procurer en abondance résines et goudrons. Mais ils n’en voulaient pas, puisqu’on allait sacrifier l’élevage des moutons, que l’ombre des pins rend malades. Et l’on fit pacager dans les semis, brûler des forêts, et l’on fit des procès. On voulait bien s’approprier les terres vacantes des communes, mais à condition de ne pas payer d’impôts. Ici, on aimait mieux laisser les hectares aux communes, d’où les considérables forêts communales d’aujourd’hui. Là, bienfait de l’oligarchie, quelques-uns s’arrangeaient pour se les partager, d’où les énormes propriétés privées actuelles qui se chiffrent par milliers d’hectares. Aux amateurs de résidences secondaires, qui se flattent de leurs 3 000 ou 4 000 mètres carrés, les propriétaires demandent innocemment : « Cela fait combien d’hectares ? » On connaît enfin la question sociale et la question de l’Etat. Du coup, c’est l’antique et farouche indépendance des Landais qui se réveille. Désormais, ils existent.
PRÉFACE DE BERNARD MANCIET
Si les Landes de Gascogne, ou plutôt la forêt de Gascogne, qui couvre un million d’hectares a gardé une rude personnalité, elle le doit en partie aux légendes qu’elle a entretenues : il ne s’agirait que d’un désert, d’habitants sauvages, juchés sur des échasses. Nous avons essayé de lui conserver cet aspect mystérieux, aussi bien dans nos romans, dans nos poêmes que dans les statistiques les plus exactes.
Force nous est, toutefois, d’esquisser son caractère à la fois archaïque et ultra-moderne, passant du château en ruines de Sigognac aux industries nouvelles.
Si renfermé qu’il demeure, le petit peuple landais s’inscrit toutefois dans les grands mouvements migratoires d’Oléron à Compostelle, les processions de camions sur la route d’Antonin, ou le cabotage de l’actuel « arc atlantique ».
Le Landais de la Grande-Lande se veut solitaire dans sa vaste forêt. Mais il connaît d’autres solitudes : celles des aventuriers. Comme celles des Basques, la diaspora s’est répandue au-delà de notre continent. Comment ne pas citer les marins qui, les premiers, dans un sens ou dans l’autre, ont bouclé le tour du monde? Ou l’un des plus grand aventurier sans doute, qui a fondé un empire immense, Saint Vincent de Paul ?
Bernard Manciet
Trensacq, le 15 mai 2005